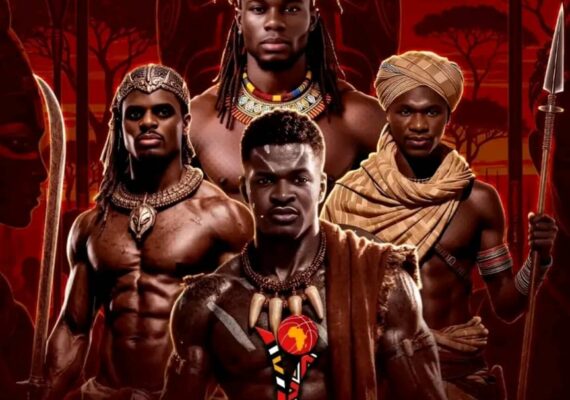Plus d’une décennie après l’adoption d’une réglementation stricte visant à éliminer les sacs et emballages plastiques non biodégradables, le Cameroun, en 2025, est confronté à une réalité amère : le plastique interdit est toujours omniprésent, étouffant les villes et les systèmes de drainage. Le « mythe de la biodégradabilité » et l’absence d’une chaîne de contrôle efficace sont les principaux responsables de cette persistance.
L’interdiction, édictée à travers un arrêté conjoint du Ministère de l’Environnement et du Ministère du Commerce, visait initialement à bannir tous les plastiques dont la biodégradabilité n’était pas certifiée. Cet objectif, noble sur le papier, s’est heurté à un manque criant d’outils et de normes claires sur le terrain.
En 2025, le pays ne dispose toujours pas d’un réseau de laboratoires nationaux suffisamment équipés pour effectuer des tests rigoureux et rapides afin de certifier la biodégradabilité ou le compostage des matériaux plastiques. Cette lacune a rendu l’application de la loi par les inspecteurs de commerce et les douaniers presque impossible.
Face à ce vide, les autorités ont introduit une tolérance pour les emballages plastiques d’une épaisseur supérieure ou égale à 61 microns. L’idée était de privilégier les plastiques réutilisables ou plus robustes. Cependant, cette clarification, bien que pragmatique, a dilué l’objectif initial de la biodégradabilité, autorisant de facto des plastiques non biodégradables s’ils sont assez épais, et laissant les consommateurs incertains quant à ce qui est légal ou non.
Le résultat est une confusion réglementaire qui a permis aux opérateurs peu scrupuleux de continuer à inonder le marché avec des produits bon marché, souvent importés illégalement.
Le commerce informel, cheval de Troie du plastique
La véritable bataille n’est pas menée dans les usines de production locales, mais aux frontières et dans les marchés informels. Il faut dire que, le plastique interdit, produit dans les pays voisins ou importé via des réseaux clandestins, pénètre facilement le territoire. Les saisies spectaculaires, régulières en 2025 dans les ports et les grandes villes comme Douala et Yaoundé (plusieurs milliers de tonnes sont saisies annuellement), témoignent de l’ampleur du trafic. Malgré ces efforts, les profits sont tels que les réseaux se reconstituent rapidement.
Aussi, il reste que le sac plastique fin et non biodégradable reste significativement moins cher que ses alternatives biodégradables ou les sacs en tissu/papier. Dans un contexte économique difficile, les commerçants, et par extension les consommateurs, optent majoritairement pour la solution la moins coûteuse, perpétuant le cycle de la demande pour l’interdit.
Cependant, les efforts pour développer une filière locale de production de bioplastiques ou d’emballages écologiques (à base de papier, de feuilles, etc.) n’ont pas encore atteint une échelle suffisante pour satisfaire la demande nationale à un prix compétitif.
La situation en 2025 exige un changement de stratégie. Au lieu de se concentrer uniquement sur le concept difficilement mesurable de la « biodégradabilité », le Cameroun devrait consolider ses efforts sur : comment déployer des ressources accrues pour éradiquer la contrebande ; investir massivement dans la collecte et le recyclage des plastiques autorisés (à 61 microns) pour créer une valeur économique et réduire la quantité de déchets qui se retrouve dans la nature ; adopter une campagne nationale durable pour changer les habitudes d’utilisation des sacs à usage unique.
Sans une approche multisectorielle et des outils d’application concrets, le mythe de la biodégradabilité restera un idéal inatteignable, et le pays continuera de crouler sous les déchets plastiques.
Ernesthine BIKOLA