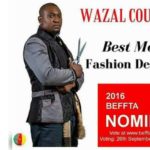À Lomé, l’Hôpital Dogta-Lafiè, vitrine médicale du Togo et symbole d’excellence sanitaire, est la cible d’une campagne de discrédit savamment orchestrée. Derrière les critiques, se dessinent moins des préoccupations médicales que des calculs corporatistes et des rivalités politiques.
Pensé comme un projet de souveraineté sanitaire, l’hôpital Dogta-Lafiè devait mettre fin à la dépendance du Togo aux coûteuses évacuations médicales vers l’étranger. Doté d’équipements de dernière génération – blocs opératoires ultramodernes, imagerie de pointe, réanimation et laboratoires spécialisés – et d’un personnel sélectionné selon des critères exigeants, il se positionne comme un centre hospitalier de niveau 4, une référence dans toute la sous-région. À lui seul, il incarne une ambition : offrir aux Togolais les mêmes chances d’accès aux soins que dans les capitales médicales internationales.
Un hôpital d’excellence devenu épouvantail politique
La montée en puissance de l’hôpital Dogta-Lafiè dérange. Très vite, l’établissement a été pris pour cible dans une campagne de critiques savamment orchestrée. Sur les réseaux sociaux, relayés par certains médias et amplifiés par des acteurs corporatistes, les sobriquets se multiplient. Le plus marquant, « hôpital des riches morts », illustre le ton acide de cette offensive : une formule cynique qui, au lieu de valoriser la prouesse technique et organisationnelle, réduit Dogta-Lafiè à une caricature. Comme si le fait que des patients y décèdent – ce qui arrive dans tous les hôpitaux du monde – suffisait à délégitimer son rôle et ses avancées.
Derrière cette guerre de mots, se jouent en réalité des enjeux de pouvoir et d’influence. Pour certains acteurs du secteur de la santé, Dogta-Lafiè menace un équilibre établi. Il remet en question des pratiques lucratives liées aux évacuations sanitaires, dérange certains réseaux médicaux habitués à capter les patients « solvables » et redistribue les cartes en matière de prestige professionnel. Politiquement, l’hôpital devient aussi un symbole. Projet phare du gouvernement, il est instrumentalisé dans le débat public, transformé en terrain de confrontation entre partisans et opposants.
« Des patients y meurent », répètent les détracteurs. Mais cette accusation, sortie de son contexte, occulte une évidence : soigner ne signifie pas toujours sauver. «Sauver des vies reste notre mission première, mais il arrive que la médecine se heurte à l’inéluctable », nous confie un des responsables. Dans les cas extrêmes, offrir une prise en charge digne, soulager la douleur et accompagner les familles est un acte médical aussi essentiel que la guérison. Dogta-Lafiè ne fait pas exception à cette règle universelle. Sauf que dans ce cas togolais, chaque décès est brandi comme un argument à charge, alimentant l’idée que l’hôpital est une promesse trahie, alors qu’il est en réalité une conquête fragile menacée par des intérêts croisés.
Les intérêts corporatistes en ligne de mire
Derrière ce procès en sorcellerie, c’est le modèle même de Dogta-Lafiè qui irrite. L’hôpital documente chaque acte, évalue ses praticiens, et ne laisse aucune place à l’approximation. Une exigence qui bouscule un système où la complaisance reste trop souvent tolérée. Un praticien, sous couvert d’anonymat, résume ainsi la fracture : « Ce centre est vu comme un intrus. Non pas parce qu’il échoue, mais parce qu’il réussit là où les autres peinent.»
La polémique est donc moins médicale que symbolique. Dogta-Lafiè incarne un standard que d’autres institutions, publiques comme privées, peinent à atteindre. Plutôt que de tirer le secteur vers le haut, certains préfèrent alimenter le soupçon.
Si l’hôpital dérange, ses résultats parlent d’eux-mêmes. Diplomates, hauts fonctionnaires, personnalités publiques : tous préfèrent désormais Lomé à Genève ou Abidjan pour leurs soins spécialisés. Les statistiques confirment ce basculement : plus de 80 % des évacuations sanitaires ont été évitées grâce à Dogta-Lafiè.
Le phénomène dépasse même les frontières togolaises. Des patients venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon ou encore du Tchad y trouvent désormais des solutions médicales de haut niveau, accessibles et rapides.
Sanctuariser l’excellence publique
Au-delà du cas Dogta-Lafiè, une interrogation s’impose : peut-on laisser une minorité décrédibiliser un projet qui incarne la modernité sanitaire d’un pays ? Ce qui est visé n’est pas seulement un hôpital, mais une idée : celle qu’un établissement public peut atteindre les standards d’excellence et devenir un symbole national.
À l’heure où le Togo ambitionne de se positionner comme un hub médical régional, Dogta-Lafiè devrait être consolidé et soutenu, plutôt que fragilisé par la suspicion ou miné par des attaques corporatistes. Cet hôpital n’est pas un miracle tombé du ciel : il est le fruit d’un choix stratégique assumé, d’investissements lourds et d’une volonté politique de bâtir une alternative crédible aux évacuations médicales coûteuses.
Dogta-Lafiè démontre qu’il est possible de soigner dignement au Togo, et même d’offrir ses services au-delà des frontières. Le véritable enjeu est donc clair : défendre et renforcer ce modèle au lieu de céder aux manœuvres d’intérêts qui n’ont rien à voir avec la santé publique, mais qui cherchent à fragiliser un acquis collectif.
Gabriel MBARGA