
Dans cet État charnière de l’espace lusophone de la CEDEAO, la stabilité n’est jamais un acquis. Le récent putsch rappelle une vérité que les juristes et politistes formulent depuis des décennies : lorsqu’un système politique n’a pas traité ses causes profondes de vulnérabilité, la rupture n’est pas une exception, elle est la règle.
La Guinée-Bissau reste cette énigme politique de l’Afrique de l’Ouest, où chaque période d’accalmie n’est qu’un bref répit avant une nouvelle secousse institutionnelle. Depuis l’indépendance en 1974, aucun président n’a achevé son mandat dans la sérénité. Les transitions sont brutales, les recompositions imprévisibles, et le paysage politique s’apparente davantage à ce que Samuel Huntington appelait un « ordre politique en changement », c’est-à-dire un système où les institutions formelles n’ont jamais réussi à prendre le pas sur les forces sociales et militaires qui les traversent.
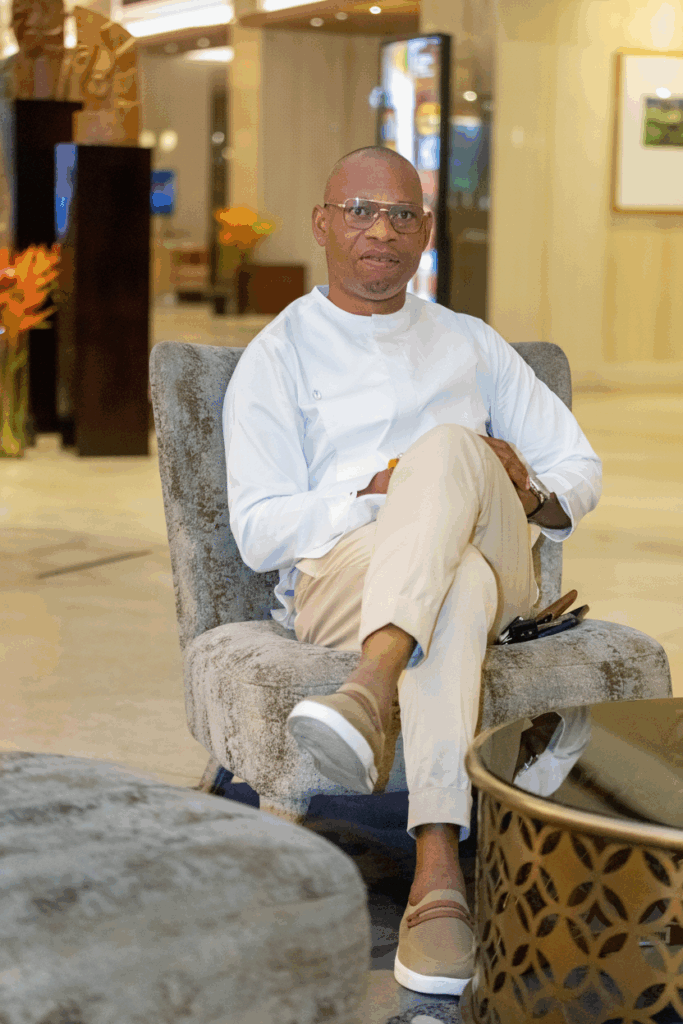
Le dernier coup d’État, loin d’être une surprise, confirme une constante historique : en Guinée-Bissau, nul n’est vraiment en sécurité, ni le chef de l’État, ni le gouvernement, ni les citoyens, parce que l’État lui-même ne repose pas sur une architecture institutionnelle capable de contenir les tensions. L’apparente trêve qu’avait instaurée Umaro Sissoco Embaló n’était qu’une suspension momentanée du « péril bisau-guinéen », jamais sa résolution.
Une instabilité enracinée dans l’histoire institutionnelle
La racine du problème est connue des spécialistes du droit constitutionnel africain : la séparation des pouvoirs n’y a jamais été véritablement consolidée. Le constitutionnaliste Juan Linz rappelait que dans les systèmes politiques fragiles, « les crises deviennent structurelles lorsque les acteurs se considèrent au-dessus des règles qu’ils prétendent défendre ». La Guinée-Bissau illustre parfaitement ce diagnostic.
Son armée, héritière directe de la lutte de libération, s’est forgée une légitimité révolutionnaire qui l’a progressivement placée au-dessus des institutions civiles. Elle n’a jamais été républicanisée, ni remise dans un cadre strict de subordination au pouvoir politique. Fragmentée, traversée d’allégeances personnelles, jalonnée de commandements parallèles, elle fonctionne comme un centre autonome de décision, un « pouvoir veto » au sens de Robert Dahl : un acteur capable de bloquer, suspendre ou renverser le fonctionnement normal du système.
Dans ce contexte, même les périodes d’apparente stabilité restent superficielles.

Sous Embaló, le pouvoir exécutif semblait consolidé, mais la discipline militaire n’était qu’une façade, obtenue par l’autorité personnelle plutôt que par des réformes institutionnelles profondes.
Une classe politique éclatée, un État poreux
À la fragilité militaire s’ajoute une scène politique fracturée où les partis, notamment le PAIGC, ont été minés par des dissensions internes, des rivalités de leadership et une incapacité à se doter de mécanismes stables de gouvernance. Les coalitions se font et se défont au rythme des ambitions personnelles, créant des brèches dans lesquelles l’armée s’engouffre avec une facilité déconcertante.
L’économie, parmi les plus fragiles de la région, ajoute une dimension explosive. L’État est poreux, traversé par des trafics transnationaux, particulièrement le narcotrafic, qui finance des réseaux clandestins capables d’acheter loyautés militaires et connexions politiques. Le pouvoir politique devient alors, non pas un espace de décision publique, mais une ressource à capturer. Ce que le politiste Jean-François Bayart appelle « la politique du ventre ».
Dans un tel environnement, la corruption n’est pas seulement un problème éthique. Elle est devenue un mode de régulation du système et lubrifie les rapports entre élites, mafia et factions militaires, au détriment de l’intérêt général.
Les institutions censées représenter l’État, parlement, Cour constitutionnelle, exécutif, n’ont jamais acquis l’autorité nécessaire pour arbitrer les crises. Le droit y est souvent interprété selon le rapport de force du moment. Dès lors, le coup d’État perd sa nature exceptionnelle et devient un instrument « normalisé » d’ajustement politique. C’est ce qui fait de l’état d’exception, la règle.
Le retour du péril éternel
L’arrivée au pouvoir d’Umaro Sissoco Embaló avait brièvement fait croire à un tournant. Son style martial, centralisé, ambitieux, semblait imposer un cadre vertical à une armée habituée à dicter sa loi. Mais une trêve n’est jamais la paix.
Derrière l’apparente rigidité du système, les frustrations dans les casernes, les rivalités entre réseaux politico-militaires et la lassitude du pouvoir ont continué à miner la stabilité. Rien n’avait été réformé ; tout avait été suspendu. Le nouveau putsch n’est donc pas un accident. Il est le symptôme d’un système qui revient à son état naturel : une instabilité structurelle devenue mécanique.
La Guinée-Bissau se retrouve une fois encore à la croisée des chemins, déchirée entre le désir d’un renouveau institutionnel et la réalité d’un État où rien n’a été suffisamment consolidé. Les réformes indispensables, dépolitisation de l’armée, assainissement économique, clarification constitutionnelle, renforcement de l’État de droit, n’ont jamais été menées jusqu’au bout.
Tant que ces causes profondes ne seront pas traitées, le pays restera enfermé dans une boucle interminable de ruptures politiques.

Ce cycle n’érode pas seulement la gouvernance, il épuise la population, brise les ambitions de la jeunesse et menace la sécurité collective de la CEDEAO, une sécurité de plus en plus très précaire.
Pour le peuple bissau-guinéen, pour une jeunesse lassée d’espérer un avenir qui recule sans cesse, et pour une sous-région déjà fragilisée par les crises successives, la rupture avec ce « péril éternel » est un impératif historique. Mais tant que les blocages structurels perdureront, rien ne garantit que cette rupture adviendra. Les trêves continueront sans doute de se succéder, aussi fragiles que trompeuses, et la paix durable restera un horizon lointain.
Sans institutions solides pour résister aux tempêtes politiques, la Guinée-Bissau risque de s’enfoncer davantage dans une instabilité devenue sa seule constante, une tragédie politique dont personne ne sort indemne.
Donis AYIVI, Politiste et Consultant en Communication








